Denoël 2007, 436 pages
Source : Parutions.com
Dans son nouvel ouvrage, Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste, ancien président de l’Association freudienne internationale, auteur de nombreux ouvrages, dont Un monde sans limite et L’Homme sans gravité en collaboration avec Charles Melman, s’interroge sur les changements qui, en quelques années aussi bien dans le droit, la médecine, l’éducation, la culture, l’économie, la sexualité, ont émergé dans la société occidentale. Certains philosophes, romanciers, essayistes, ou psychanalystes n’ont pas manqué de les relever. Citons pêle-mêle On achève bien les hommes et L’Art de réduire les têtes de Dany-Robert Dufour, L’Enseignement de l’ignorance et Impasse Adam Smith de Jean-Claude Michéa, L’Homme économique de Christian Laval, sans oublier les essais drolatiques de Philippe Muray (L’Empire du bien, Exorcismes spirituels). D’autres ont exulté à leur apparition, pensant que la société postmoderne était en bonne santé physique et mentale. D’autres s’en inquiètent comme Jean-Pierre Lebrun. Qu’en est-il ?
La Perversion ordinaire débute par une introduction consacrée à la crise de la légitimité qui caractérise la société actuelle. La suite contient deux parties : une première, comprenant quatre chapitres, aborde le volet sociétal de la question, autrement dit la description et l’analyse des changements qui ont conduit à une véritable mutation du lien social ; une seconde, recouvrant quatre autres chapitres, décrit les effets de ces changements sur la subjectivité. Un chapitre central met en évidence la place stratégique de l’éducation, lieu par excellence où se nouent lien social et subjectivité. La conclusion évoque la nouvelle responsabilité du sujet dans cette société postmoderne.
Voilà en tout cas un livre qui devrait apporter quelques lumières aux personnes en plein désarroi, un livre qui fait donc sens. Pour cela, Jean-Pierre Lebrun revient aux bases de l’humanisation. Tentons de le résumer pour en comprendre l’importance car le livre explique quelques notions de base en psychologie.
Pour être homme, pour accéder au langage, il faut perdre notre rapport immédiat et animal au monde et aux objets, renoncer à la toute-puissance infantile, faire le deuil de cette soustraction de jouissance, de ce moindre-jouir (à ne pas confondre avec l’acception usuelle de « plaisir que l’on goûte pleinement »). Parler signifie donc que je consens au vide, à la perte, à la négativité, nous dit Lebrun. C’est ce que les psychanalystes appellent la «castration». Tout sujet doit effectuer cette subjectivation pour soutenir la division entre jouissance et désir. La différence entre les deux est simple : par exemple, boire un vin peut être qualifié de plaisir mais l’alcoolisme emporte le sujet vers une jouissance mortifère. Le plaisir suppose l’intégration d’une limite, contrairement à la jouissance qui n’en suppose aucune. L’enfant, à ce stade, est d’abord ce que ses parents disent de lui. Puis en commençant à parler, en répétant les mots qu’il entend, il endosse ce qui est dit autour de lui et ce qui est dit de lui. Puis vient le stade du Non ! C’est à partir de sa propre position subjective qu’il soutiendra sa parole. En se réappropriant cette négativité, le sujet habituel trace sa propre voie. Il n’y arrive qu’après s’être autorisé à faire objection à l’Autre.
S’il en va un peu autrement de nos jours comme on va le voir, le social était auparavant organisé entre autres sur le modèle religieux. On reconnaissait l’existence d’une transcendance comme celle du roi, du chef, du père, du maître, du professeur… Vaille que vaille, ce moment reprenait la transmission du moins-de-jouir à une société construite autour de la place prévalente du père. Si cette dernière était critiquable, il n’était pas nécessaire de se débarrasser au passage de toute hiérarchie. De plus, cela n’abolit pas pour autant la différence des places prescrite par la structure du langage. Ce système ayant été ébranlé, tout se passe comme si nous nous étions affranchis non seulement de la nécessité d’avoir affaire à une transcendance concrète, mais de l’intérêt de conserver un quelconque transcendantal (extériorité). Or, pour se libérer des figures de l’autorité, il faut qu’on dispose d’un psychisme d’adulte. L’enfant n’est pas capable de se séparer d’une telle figure s’il ne l’a pas rencontrée auparavant. Il arrive toujours dans un monde déjà là avant lui et de ce fait sa dépendance initiale est inéluctable.
A la verticalité, au transcendant, à la vérité, on a opposé l’horizontalité, l’immanent, l’aléatoire : le relatif excessif. C’est toute la vie collective qui, de ce fait, a basculé. Elle ne se soutient plus d’un ordre préétabli qui transmet des règles, mais d’un «ordre» qui doit émerger des partenaires eux-mêmes. Comment concilier tous les avis différents ? Tout cela est-il même compatible avec l’idée même d’éducation ? Comment un enseignant peut-il faire cours s’il ne dispose plus des conditions minimales pour assurer son enseignement ? Dans un tel régime, l’autofondation et l’individualisme sont prévalents. C’est ce monde sans limites qui est actuellement promu, un monde où toute autorité (dieu, père, professeur, etc.) est battue en brèche car elle limite la toute puissance infantile et prétend se passer du manque fondateur. «Nous pensons, quant à nous, qu’une telle économie subjective a effectivement toujours existé, mais que c’est sa prévalence et donc sa banalisation qui représentent aujourd’hui une essentielle nouveauté. Car à partir du moment où une telle économie devient dominante, cela vient bouleverser radicalement notre façon d’être au monde. Ce changement nous oblige à réviser toute notre conception de la normalité», écrit Lebrun. Et il emploie le terme de néo-sujet, reprenant aussi la formule de Charles Melman, «nouvelle économie psychique», pour désigner le régime sur lequel vit le néo-sujet.
Pour Lebrun, nous passons d’un système consistant et incomplet (hiérarchique et prenant en compte le manque fondateur) à un système complet et inconsistant (sans place pour la négativité). Renversement radical. C’est à une mutation du lien social qu’on assiste, mutation provoquée par la conjonction de trois forces : le discours de la science, la dérive de la démocratie en démocratisme et le développement du libéralisme économique débridé. Un changement qui entraîne l’éviction de ce qui installait une possibilité d’articulation entre le tous et le singulier. Mais aussi entre ce que l’on consent à perdre pour le tous et ce que l’on soutient de sa singularité. Car c’est en reconnaissant l’existence de cette articulation que l’on peut à la fois et en même temps être membre d’un groupe social et pouvoir être reconnu dans ce que l’on a de singulier. Nous avons affaire à des individus devenus adultes sans avoir été obligés de quitter l’enfance et sans même le savoir. C’est l’enfant généralisé. Faire de l’enfant un roi ou le traiter comme un adulte, c’est l’empêcher de devenir responsable. Pour la première fois dans l’Histoire, la famille protège ses enfants de la société !
Pour Lebrun, dans cet «ordre», le symbolique ne peut plus appréhender le réel, un réel devenu source d’injustice, comme un traumatisme qu’il faut réparer de toute urgence. Les répercutions sont nombreuses comme l’abolition de toute différence, y compris la différence générationnelle, mais aussi la phobie scolaire, les procès en tous genres, l’homoparentalité puisqu’il s’agit non seulement de tout égaliser mais d’accepter les revendications égotistes pour que chacun accède à sa toute-jouissance. L’inégalité était une donne de départ, comme allant de soi, donne qu’il fallait transformer. Nos démocraties posent d’emblée l’universalité du principe d’égalité. C’est ce que Lebrun appelle le démocratisme, conception de la démocratie qui fait l’impasse sur la reconnaissance de la perte, de la soustraction de jouissance et où chacun peut faire ce qu’il veut.
Sommes-nous en train de devenir pervers, se demande alors Jean-Pierre Lebrun ? Question cruciale que pose le livre. Pas structurellement, dit-il. «Ce n’est pas parce que des sujets participent à une économie perverse qu’ils sont eux-mêmes pervers, au sens où ils relèveraient de la structure perverse.» Il invente un mot, celui de mèreversion pour caractériser cette perversion ordinaire. Le tableau clinique du néo-sujet est celui d’un sujet resté enfant de la mère. Expliquons un peu.
En règle générale, l’enfant est en rapport avec la mère, celle-ci étant son premier autre («autre même»), la première personne qui occupe pour lui la scène de l’Autre. C’est dans un deuxième temps que vient le rapport au père (un «autre autre»). Il faut en passer par cet «autre autre» pour poser correctement l’altérité, car il ne suffit pas d’avoir eu affaire à la mère pour vraiment prendre la mesure de ce qu’est l’autre. C’est en cela que ce passage d’un premier autre à un second est le marchepied incontournable pour accéder à la vie en société. Sans cela, le sujet se retrouve à démentir à la soustraction de jouissance, et à s’enfermer dans la croyance qu’il y a moyen de ne pas se servir de l’instance paternelle (donc de l’autorité). En restant seulement enfant de sa mère, le néo-sujet pratique le démenti pour éviter la subjectivation ; le vrai pervers, lui, fait du démenti son mode même de subjectivation, lequel lui permet d’annihiler l’altérité de l’autre en l’instrumentant. Cependant, le néo-sujet et le pervers ont en commun d’importantes proximités de fonctionnement, nous dit Lebrun. Nous avons bien affaire avec le démenti chez les néo-sujets à un mécanisme pervers dans la mesure où il agit dans la perversion, mais sans pour autant que ne se soit structurée nécessairement une perversion chez le sujet qui l’utilise. Du côté de la perversion, une structure, du côté du néo-sujet, un évitement, voire un refus de structuration. Tout se passe comme si le double discours actuel du social, proposant de jouir sans entrave tout en sachant en même temps que la limite à la jouissance est toujours nécessaire, invitait le sujet à soutenir le maintien de deux possibilités contradictoires face à une perception. Nous n’avons pas affaire à un Nom-du-Père forclos (entraînant la psychose), ni à un père faible (hystérie), ni non plus à un père auquel la mère fait la loi (perversion stricte) mais plutôt en ce temps de perversion ordinaire, à un père repoussé dans les marges, toujours bel et bien là mais inopérant, désavoué, comme sans voix.
Et l’on comprend mieux avec ce livre ce qui se passe tous les jours autour de nous. Le néo-sujet, faute d’un ancrage dans la négativité, est comme sans domicile fixe, en errance, nomade ouvert à tous vents, sans habitudes ni épaisseur, prêt à saisir quand il le peut l’opportunité qui se présente. Son caractère est imprévisible, sans orientation bien définie. Il se sentira comme invertébré, flexible, sans capacité critique, absorbant ce qui l’entoure comme une éponge et d’une plasticité ouverte à toutes les manipulations. Une invitation à ne plus se confronter aux avatars du désir et à préférer l’engluement dans la jouissance mortifère (intériorisation du néo-libéralisme économique, selon Marcel Gauchet) Toute une pathologie en découle, y compris de tirer à vue dans une rue à force d’avoir été désubjectivisé ou d’avoir recours sans arrêt à l’Etat pour résoudre son mal être…
Dans ce nouveau régime qui prône la toute jouissance, les sujets ignorent que ce qu’ils privilégient, c’est un mode de jouir où le lien à l’objet n’est plus médiatisé par le signifiant, le langage. L’objet devient l’organisateur de la jouissance. Faute d’avoir fait le travail de séparation que permet le langage, c’est alors l’addiction qui est au programme. Ce «besoin» d’être dans l’excès sert une logique de la sensation qui prévaut sur celle de la représentation. On comprend pourquoi le néo-libéralisme y trouve son compte. Lebrun emploie un néologisme pour caractériser ce phénomène, l’entousement, terme voulant dire pris dans la masse, pris dans le tous, grégarisés. À cet égard, il est faux de dire que nous vivons dans une société individualiste mais plutôt dans une société-troupeau, poussant l’individu à éviter sa division subjective, à troquer son trajet de subjectivation contre une appartenance à la masse : une individuation plutôt qu’une individualisation.
Ce livre dense et simple, même s’il demande une lecture soutenue à laquelle on parvient aisément, est ainsi à mettre entre toutes les mains pour commencer à saisir les mutations du monde contemporain.
Yannick Rolandeau


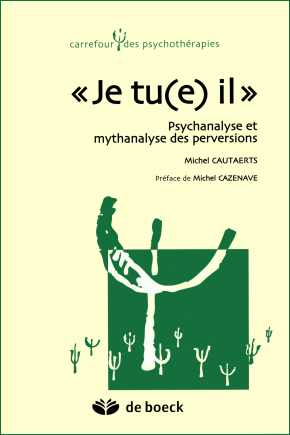 « La peste du XXIeme siècle », c’est ainsi que Michel Cautaerts qualifie les perversions narcissiques. La plupart du temps cachées, elles minent la vie d’un grand nombre de victimes, tant au niveau des couples, des familles que des entreprises.
« La peste du XXIeme siècle », c’est ainsi que Michel Cautaerts qualifie les perversions narcissiques. La plupart du temps cachées, elles minent la vie d’un grand nombre de victimes, tant au niveau des couples, des familles que des entreprises.